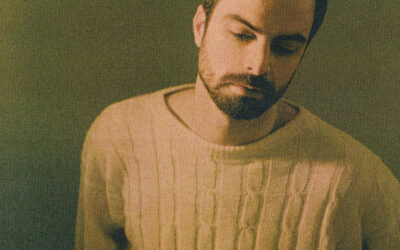Éloignons-nous un peu de la pop française que l’on chérit tant à La Vague Parallèle pour nous envoler en direction du Sahara. Si la musique est un voyage, elle est aussi un formidable moyen de faire passer des messages de manière pacifique. Avec leur blues-rock touareg, les nomades de Tamikrest en sont un formidable exemple. Discussion d’une rare sincérité avec Ousmane, le leader de la formation tamashek, pour une plongée au cœur des enjeux de ce peuple du désert.
La Vague Parallèle : Bonjour ! Merci de m’accorder quelques minutes avant votre concert. Tamikrest, c’est une musique avec beaucoup d’influences. Comment la décrirais-tu ?
Ousmane : On peut l’appeler assouf, ce qui veut dire la nostalgie toujours. C’est une musique locale, révolutionnaire, qui a été beaucoup jouée dans les années 80. Il y a une similarité entre le blues et la musique tamashek, c’est une nostalgie d’exil. Nous, on était vraiment fan de beaucoup d’artistes qui ne sont pas de chez nous, comme les grands bluesmen, BB King, Eric Clapton… En tant que musicien, tu as ta créativité et tes influences. On essaye de faire notre propre musique à partir de tout ça. Surtout, pour créer quelque chose d’unique à soi, il ne faut pas créer de barrières par rapport à la musique, aucune limitation.
LVP : Y a-t-il une volonté de créer une musique qui puisse toucher à la fois la culture tamashek et occidentale ?
O : Je ne pense pas qu’on fasse de la musique de chez nous. On est complètement ouvert. On joue partout, on cherche à faire découvrir notre culture, notre langue partout dans le monde. Quelques fois, je pense que ce n’est pas négatif qu’il y ait ces passerelles entre les musiques, elles servent de transition. Quand tu joues quelque chose de vraiment local, ça peut être dur pour un public non initié de comprendre cet art. Mais si tu fais un pont, par exemple, ça facilite la découverte.
LVP : D’où le fait de travailler avec le producteur européen Mark Mulholland ?
O : Je n’ai en vérité jamais travaillé avec un producteur africain. Du moment où tu te comprends très bien avec le producteur, tu es dans le vrai. Il n’est pas censé t’amener à l’opposé de ce que tu recherches, mais plutôt t’emporter là où tu veux aller.
LVP : Le dernier album, Kidal, a été enregistré au Mali, contrairement aux précédents. Peux-tu nous en dire plus sur ce choix ?
O : Ce n’était pas dans mon intention d’enregistrer à Bamako (rires). Depuis 2012, c’était un peu dur d’aller là-bas. D’une part, la situation n’est pas top, et d’autre part, les équipements sont souvent mieux dans les grosses villes avec beaucoup de moyens. En vérité, ce que je rêve de faire, c’est d’avoir le matériel suffisant pour enregistrer au milieu de nulle part dans le désert. Profiter de l’inspiration du lieu et de sa tranquillité. Maintenant, c’est un peu difficile, ce n’est plus comme avant. Et amener des personnes étrangères est risqué. Donc si tu ne peux pas avoir cet extrême, autant faire l’autre extrême : trouver le meilleur studio possible. Que ce soit à Bamako, en Europe ou au Canada, ça reste une grosse ville à mes yeux. Mark a un studio là-bas car il a produit Tony Allen. Et comme quelques fois ça peut être compliqué de voyager pour des raisons financières ou de visa, c’était la meilleure solution.
LVP : En revanche, les chansons ont été composées dans le désert ?
O : Oui, tout à fait.
LVP : Tu commences en général plutôt par la guitare ou par les mots ?
O : Il n’y a pas de règles. Il faut juste jouer de la musique face au désert. Quelques fois, tu trouves des mots, et tu cherches donc la composition dans la guitare. Ensuite, tu l’amènes aux autres membres, et il faut voir si ça fonctionne avec tout le monde.
LVP : Parlons de ces mots, justement. Tu chantes donc en tamashek. C’est une manière de répandre cette culture, de montrer qu’elle persiste ?
O : Tout à fait. C’est exactement ça. C’est sûr que pour le public occidental, et même africain, c’est plus facile de chanter en anglais. Mais c’est très important de chanter notre langue pour la sauvegarder. D’autant plus que nous faisons, je ne dirais pas des concessions, mais des ouvertures à la musique occidentale. Pour moi, il y a bien sûr les paroles, mais c’est la mélodie qui attire l’attention. Moi, par exemple, je ne parle pas anglais. Pourtant, j’écoutais tellement d’artistes qui ne parlent qu’anglais dans mon enfance, comme Bob Marley et beaucoup d’autres. Tu es d’abord attiré par la musique, et c’est ensuite cette musicalité qui te pousse à savoir ce que l’artiste chante. Pour le moment, nous sommes juste dans la musique. On ne peut pas dire que c’est vraiment de la musique du désert, elle peut donc être facile à comprendre. Après ça, les gens feront leurs recherches s’ils le souhaitent.
LVP : Musicalement, il y a une chanson que j’adore sur l’album, Erres Hin Atouan. Peux-tu justement expliquer dans les grandes lignes le sens des paroles ?
O : C’est très psychédélique et philosophique. C’est une chanson qui parle d’une vie personnelle. C’est accentué sur le fait d’oublier tout le passé et ses malheurs, les souvenirs tristes. Tout oublier, me reformater pour aller de l’avant. Une nouvelle chose : Erres Hin Atouan signifie “si je pouvais“.
LVP : C’est intéressant, car les mélodies sont souvent très relaxantes. Peut-être contrastent-elles avec les paroles ?
O : Au contraire, quelques fois la mélodie n’est pas très loin de l’explication de la chanson. Tu ne peux pas chanter une idée sur une musique en totale opposition à cela. Même si en tant qu’artiste, je pense que même si l’on part de quelque chose de très triste, on peut rendre cela joyeux d’une certaine façon, avec une petite touche d’optimisme. C’est un peu le but de l’album.
LVP : Le fait d’appeler l’album Kidal ne doit pas être anodin, tant cette ville a eu une histoire tumultueuse récemment.
O : Je pense qu’il faut vraiment connaître le dossier du désert pour comprendre ma réponse, car c’est une situation compliquée (rires). C’est un peu difficile, mais peut-être que si je réponds tout de suite, tu comprendras un jour. C’est un truc qui date d’il y a longtemps. Avant, nous n’avions pas de frontières, nous sommes un peuple libre, on voyage comme on veut. Même si chacun a son territoire, tout le monde est libre de voyager. Il y a 60 ans, il y a eu ce découpage territorial. Des peuples se sont retrouvés divisés entre plusieurs pays. Des peuples n’ont pas pu s’intégrer dans ces nouveaux systèmes, soit parce que le système ne convient pas, soit parce qu’ils sont opprimés. Les touaregs, dont le peuple tamashek, en font partie. La situation de Kidal depuis 1958 est celle d’une région qui a toujours voulu garder son autonomie. Par tous les moyens, même s’ils sont limités. Là-bas, il y a soit des révolutions militaires, soit des révolutions pacifiques. C’est une ville qui résiste toujours pour garder un minimum de sa vie d’avant. Je pense que nous n’avons pas la même culture que le reste du Mali. C’est un pays multi-ethnique avec beaucoup de langues. Le peuple tamashek est complètement différent. Après, c’est un peu plus similaire au niveau de la musique. On écoute beaucoup Ali Farka Touré ou Toumani Diabaté, par exemple. La musique de Bamako, on l’écoute, mais elle n’a pas une énorme influence sur ce que l’on fait.
LVP : Pour en revenir à la musique, la chanson Tanakra a un esprit légèrement différent du reste de l’album. Peux-tu nous en dire un peu plus sur celle-là ?
O : C’est un duo de guitares acoustiques qui parle de voyage, composé avec Paul, le guitariste rythmique. Mais pas de simple voyages, plutôt des changements de la vie. Les objectifs, les choses que l’on a perdues, les espoirs qui sont arrivés. De manière plus générale, on voit bien que la musique rassemble les gens. Tu vois, il y a des Français dans ce groupe, mais c’est la même chose. Musique française, anglaise, orientale… Eux voyagent depuis l’âge de quinze ans dans le désert pour découvrir la musique traditionnelle, tandis que moi j’écoutais beaucoup de blues à cet âge-là. La musique, c’est avoir une couleur devant toi pour dessiner quelque chose. Tout le monde a les mêmes couleurs devant soi, mais il faut dessiner quelque chose d’autre, de propre à toi. Avec des enfances différentes mais des connaissance similaires en blues et musique traditionnelle, nous pouvons dessiner une idée : Tamikrest.
LVP : Merci pour ces explications. C’est vrai que, comme tu disais toute à l’heure, la musique traduit tes paroles pour ceux qui ne parlent pas le tamashek.
O : Quand on s’intéresse beaucoup à la musique, on finit par comprendre les chansons. Personnellement, je vois la musique comme une échelle à prendre pas à pas. Il faut commencer par les étapes 1, 2, 3 et 4 pour arriver à l’étape 10. Par exemple, si je suis au milieu du désert et que quelqu’un me balance la cassette de Bob Marley chantant War. La musique m’a immédiatement plu. Après, je comprends que la chanson parle de la guerre, mais pourquoi ? Il faut alors aller plus loin, connaitre un peu plus le dossier, comprendre pourquoi il dit ceci, pourquoi il dit cela.
LVP : Vous encouragez donc les gens à se renseigner sur la région pour mieux comprendre Tamikrest ?
O : Oui, à se renseigner sur les peuples autochtones, nomades, qui se trouvent dans le désert et sont menacés de perdre leur identité. Ce n’est pas un gros problème d’être financé par un système capitaliste ou je ne sais quoi, mais je vois qu’actuellement les politiciens ne font pas beaucoup d’efforts pour laisser les peuples garder leur identité. Même si on a une langue officielle dans les écoles, ce n’est pas une raison pour qu’on oublie celle qui est à la maison. C’est très bien qu’il y ait une nouvelle mode de s’habiller, mais on ne peut pas l’exiger sur tout le monde.
LVP : Vous vous habillez d’ailleurs de manière occidentale.
O : Finalement, oui (rires). Quand il s’agit de moi personnellement, je suis libre de le faire. Mais en prenant un exemple concret, parlons de l’écriture tamashek. Elle est plongée complètement dans l’obscurité. On ne veut pas entendre parler de notre histoire, il faudrait qu’elle soit enseignée dans les écoles. L’État devrait faire en sorte de promouvoir, d’aider les différentes anciennes cultures. Par exemple, je vois dans l’Afrique du Nord, dans le Maghreb, que des pays comme l’Algérie ou le Maroc ont effectué certaines concessions pour dire que ceux qui veulent apprendre la langue tamazight soient libres de le faire. C’est une très bonne chose.
LVP : Merci pour ces précisions ! J’essayerai de me renseigner plus en profondeur sur ce dossier.
O : C’est notre objectif. Merci à vous de parler d’artistes éloignés de votre culture, de laisser la possibilité au public de découvrir des choses différentes.

Petit, je pensais que Daniel Balavoine était une femme. C’était d’ailleurs ma chanteuse préférée.