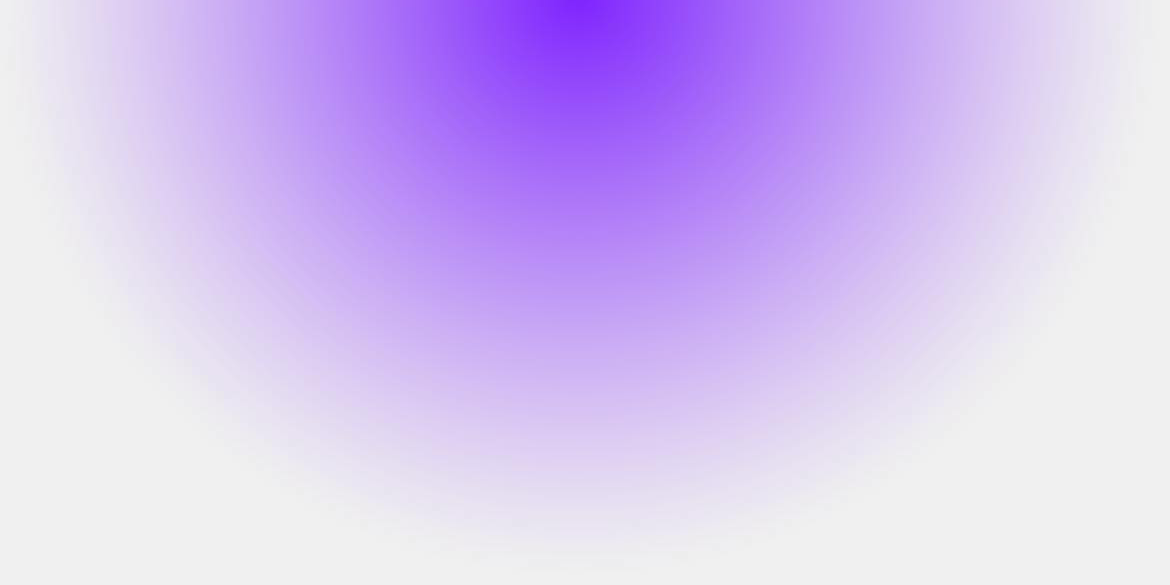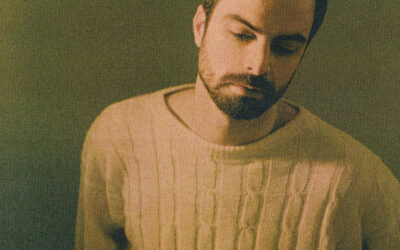Photo : Melissa Fauve
Longtemps, la machine a pris les traits d’un héros (masculin) froid et métallique, incarnation d’une rationalité virile, conquérante et verticale. Des androïdes de science-fiction aux intelligences artificielles de laboratoire, le robot a été pensé comme une extension de l’homme (masculin), comme un double amplifié de sa puissance. Mais ailleurs, à la lisière des circuits et des corps, une autre hybridation s’invente. Ce soir-là, au Botanique, choke enough a eu l’effet d’une proposition cyborg traversé d’affects, poreux et indisciplinés, échappant aux logiques binaires. C’est dans cette brèche qu’Oklou inscrit son geste musical : une voix qui s’échappe du corps, une chair qui devient onde, un devenir-machine qui ne rêve ni de maîtrise ni de domination, mais d’une intimité (partagée) liquide, troublée et vibrante.

Photo : Melissa Fauve
Prélude
Notre histoire commence le 7 février 2025, jour de la sortie de choke enough, le premier album de l’artiste française Oklou (compositrice, productrice et chanteuse). Ce premier album fusionne des influences Y2K avec des mélodies médiévales, reflétant le chemin parcouru depuis sa mixtape Galore de 2020. L’album se distingue par une production expressive et dynamique, intégrant des éléments de polyphonie imitative, une caractéristique de la musique baroque. Explorant les tensions entre intimité et isolement, il nous a offert matière à sentir, à digérer et à penser. Il est 20h au Botanique. La salle est plongée dans le noir. Une lumière, mauve ou bleue (nous ne savons plus), s’étire dans l’atmosphère, enveloppant l’espace d’une douceur indéterminée.
L’atmosphère qu’instaure Oklou entre cyborg et devenir-machine est loin du schéma robotique/héroïque de dépassement et de domination classique. En effet, le héros classique s’inscrit dans un récit de conquête : il avance, résout, tranche et maîtrise. Son histoire est linéaire, tendue vers un objectif qui justifie son pouvoir sur le monde. Ce modèle narratif, Ursula K. Le Guin (autrice de SF) l’a remis en question dans La Fiction Panier, opposant à la ligne droite de l’épée une autre manière de raconter : celle du contenant, du réceptacle, du tissu. Plutôt que de s’imposer au réel, ce récit accueille, tisse des liens, laisse place à l’imprévu. Oklou ne cherche ni à vaincre ni à s’affirmer, mais à composer avec l’environnement, à se fondre dans un flux d’interactions, à vibrer dans un espace où les subjectivités deviennent une matière plastique et sensible, traversée d’altérités.
Il fait chaud dans l’Orangerie ! Dehors par contraste, le froid est acide. Dedans, les lumières toujours tamisées, l’atmosphère est solennelle et la salle se remplit. La pénombre hurle et tout d’un coup, une mélodie émerge ! C’est la première partie, Malibu commence à intra-agir avec le clavier. Le clavier par le biais de l’électricité produit des ondes, elles-mêmes interagissant avec les corps. Les cellules des corps commencent à vibrer en rythme, dans un état entre le rêve et la réalité. L’espace est en suspension. Un vol en apesanteur, porté par des nappes synthétiques qui flottent sans point d’ancrage. Un paysage embrumé, où les mélodies se fondent dans l’arrière-plan comme des ombres en mouvement.
Photo : Melissa Fauve
” choke enough “
Le projet choke enough n’est donc pas une invitation, c’est un tableau ou une photographie. Une pause qui défile à toute vitesse. Mot à mot : « étouffer suffisamment », un verbe qui demande un complément. Il faut donc au minimum deux forces en présence aussi bactériennes soient-elle. L’une empêchant l’autre de perdurer encore un peu plus. Littéralement : « faire mourir en arrêtant la respiration », d’après la définition du moteur de recherche. Cessation de l’action de respirer entrainant l’arrêt du système vie d’une des deux forces.
Si l’arrêt se poursuit inéluctablement vers son terme, des choses se passent encore. Suffisamment… Les titres défilent, et les frontières entre sujet agissant et ce sur quoi il agit se brouillent. Véritable hybridation, la proposition d’Oklou redéfinit les codes entre humain·e/machine – organique/synthétique – le corps organique comme limite et l’électronique comme prothèse/absence de narration et un dépassement du corps comme organisme fonctionnel.
endless. Le regard suspendu sur un détail quelconque : un drap, une lumière dans la salle, un reflet de miroir. Bouge. Mouvemente-toi. Déplace-toi. Marche. Cours. Trottine. Tombe. Danse. Autant que tu le veux, autant que tu le peux. thank you for recording. Assis·e sur une balançoire ou debout sur scène près du public, une seconde passe. Tout se fige. Une seconde où il est possible de compter, un à un, les gestes qui font passer le temps.
Photo : Melissa Fauve
Voix dénaturée, entre organique et synthétique
Ce n’est pas nouveau (c’était déjà le cas pour Galore) mais l’un des éléments les plus marquants de la musique d’Oklou, c’est sa manière d’utiliser la voix. Souvent traitée et filtrée, parfois étirée ou autotunée, Oklou distord la voix qui produit un effet d’étrangeté. Littéralement : « qu’est-ce qui parle ? ». La voix n’est plus humaine au sens traditionnel, elle incarne quelque chose à mi-chemin : une voix hybride. L’effet est saisissant : oscillation entre présence et absence, incarnation et dissolution.
Si la voix est traditionnellement un marqueur de l’identité humaine (le chant, la parole comme expression de soi), Oklou la fait glisser vers autre chose, créant ainsi un espace où elle devient pure matière sonore, flux plutôt que discours. C’est un rejet du fonctionnalisme de la voix (comme outil de communication) au profit de son intensité brute, une voix qui ne signifie pas mais affecte directement.
family and friends. La sensation de chaleur est forte. Un millimètre / Le soleil est chaud / Une respiration / Les rayons sont forts… / Un muscle se détend / La pression retombe / Deux millimètres / Puis le mouvement reprend… Micro-mouvements. obvious. Clarinette numérique et tambourins. Sobriété oblige ! Une attention est requise. Quelque chose demande qu’on lui accorde de l’importance.
Synthés comme prothèses du vivant
Oklou construit ses morceaux autour de textures synthétiques très fluides, des nappes qui respirent mais sans jamais être totalement fixes. Les synthés ne sont pas seulement des instruments, ils deviennent des extensions du corps, des prothèses sonores qui amplifient l’émotion sans la réduire à une structure claire. Ici, nous faisons directement un lien avec le travail de Francis Bacon et de sa façon de traiter la chair des corps qu’il peint.
Chez Bacon, la chair des corps ne recouvre pas les muscles et les os, elle est une masse informe, malléable et expressive. De même, il nous semble que la musique d’Oklou refuse la structure nette et délimite des canons en vigueur. Ses compositions évitent les progressions classiques couplet-refrain, et fonctionnent plutôt par glissements, mutations, superpositions, décalages,… Ce qui a pour conséquence directe d’affecter la façon de faire passer l’émotion. Dans ce cas-ci, elle n’est pas racontée, elle est rendue tangible à travers la texture même du son. Elle communique directement au système nerveux, sans devoir passer par une compréhension claire du texte.
itc. Des trompettes rappelant le XVIIe siècle retentissent. Le souffle est retenu. Un léger clignement de paupière. Parfois, le battement est irrégulier. Les épaules chutent légèrement. Tension perdue. choke enough. Les doigts cessent de se crisper. Un à un, ils se détendent. Les genoux s’écartent imperceptiblement. Une expiration plus longue que les précédentes.
Photo : Melissa Fauve
Absence de narration : la musique comme intensité pure
Les textes d’Oklou sont fragmentaires, souvent dépouillés. Ils n’installent pas une histoire avec un début et une fin, mais plutôt une série de moments, d’images mentales. La sensation est vectrice et n’offre aucune prise sur un quelconque récit. La façon qu’a Oklou de naviguer dans le texte nous donne l’impression que la narration est dissoute dans la matière sonore. C’est là un geste radical dans un secteur où, souvent, le texte est le véhicule d’idées et de messages. Certains critiques pourraient même estimer que, malgré une production soignée, l’écriture peut sembler moins aboutie et, les paroles apparaissant parfois secondaires par rapport à l’ensemble musical.
Francis Bacon disait : ” On ne peut pas parler de peinture, on ne peut que tourner autour. ” Tournons donc autour, car chez Oklou vous ne trouverez pas de narration, pas de slogans, pas de mot d’ordre ou d’injonctions. C’est dans le sentir que se transforme le discours. Cette manière de procéder donne à penser. Car, loin de figer l’identité de l’interprète dans un récit, Oklou laisse place à un devenir perpétuel, une oscillation entre perte et transformation. C’est-à-dire que le fait d’être ce que l’on est renvoie à une idée d’être en mouvement, en variation constante. Tantôt humain·e, tantôt machine, voix ou synthé, l’identité est le reflet d’un état à un instant T mais n’engage sûrement pas les possibilités futures.
take me by the end. Les sourcils cessent d’être froncés et s’affaissent légèrement. Le haut du dos se décrispe, les omoplates s’éloignent doucement. Les poignets deviennent plus souples, les mains tombent mollement le long du corps. plague dogs. Les chevilles pivotent légèrement, sans s’en rendre compte. Un très léger balancement du corps, imperceptible, presque involontaire.
Photo : Melissa Fauve
Devenir-machine et dépassement du corps
Dans « choke », l’impression d’oppression, d’étouffement, est renforcée par la production qui enferme la voix et la fait se heurter aux textures électroniques. Dans « enough », il y a cette idée d’un lâcher-prise, d’une ouverture. Nous y voyons une tension entre le corps contraint par ses limites biologiques et un désir de dépassement. Non pas pour se libérer dans une transcendance, mais pour se dissoudre dans un autre régime d’existence. Cette autre existence, nous l’identifions à un devenir-machine, non pas froid et rigide, mais fluide et mutant.
Oklou crée une musique qui semble s’émanciper des catégories instrumentales et vocales habituelles. Elle joue sur un effondrement des distinctions entre humain·e et machine, mais sans devenir une mécanique rigide. Son approche rejoint l’idée du “corps-sans-organes” (Deleuze & Guattari), ce corps qui ne fonctionne plus selon des structures préétablies mais comme un champ d’intensités pures. Autrement dit : mon cœur, mes jambes, mes poumons ne sont pas là pour faire en sorte que je puisse vivre, marcher et respirer. Ces organes ont leur existence propre et les effets collectifs qu’ils produisent ont pour effet de me faire vivre.
forces. La mâchoire se desserre imperceptiblement, la langue se relâche contre le palais. La cage thoracique s’ouvre un peu plus à l’inspiration. Un pouce caresse lentement l’index, un mouvement machinal. harvest sky. Les pieds, rigides dans leurs appuis, s’ancrent plus naturellement. Un changement subtil de posture, une position plus confortable est trouvée sans y penser.
Photo : Melissa Fauve
Une esthétique du flux
Finalement, Oklou ne raconte pas, elle expose. Comme chez Bacon, il ne s’agit pas de construire une histoire, mais de montrer des forces à l’œuvre : Des voix qui ne sont plus des voix, mais des textures mouvantes. Des synthés qui ne sont plus des nappes fixes, mais des flux organiques. Une musique qui ne raconte pas, mais qui affecte directement le « corps-esprit » par les sensations. Avec cette idée, Oklou émet une critique forte de l’identité comme un procédé qui appauvrit le vivant. La vie c’est du débordement, du foisonnement et des possibilités qui se chevauchent. Au lieu de figer les choses dans une narration ou une fonction (capitaliste/productiviste), Oklou laisse place à une musique qui est une pure intensité, une pure métamorphose.
want to wanna come back. Un soupir discret soulève à peine les narines. La respiration devient plus profonde, plus silencieuse. Les bras, croisés ou tendus, se relâchent et descendent légèrement. Les orteils recroquevillés s’étalent légèrement dans les chaussures. Une baisse de tension dans la nuque, un léger roulement de la tête. blade bird. Les muscles autour des tempes cessent de tirer. La tête bascule de quelques degrés vers l’avant ou sur le côté. Une main passe distraitement sur le bras opposé, l’effleurement est inconscient.
Photo : Melissa Fauve
Artiste/chercheur – Chercheur/Artiste pluridisciplinaire. J’essaye de faire à partir de/avec plein de choses…