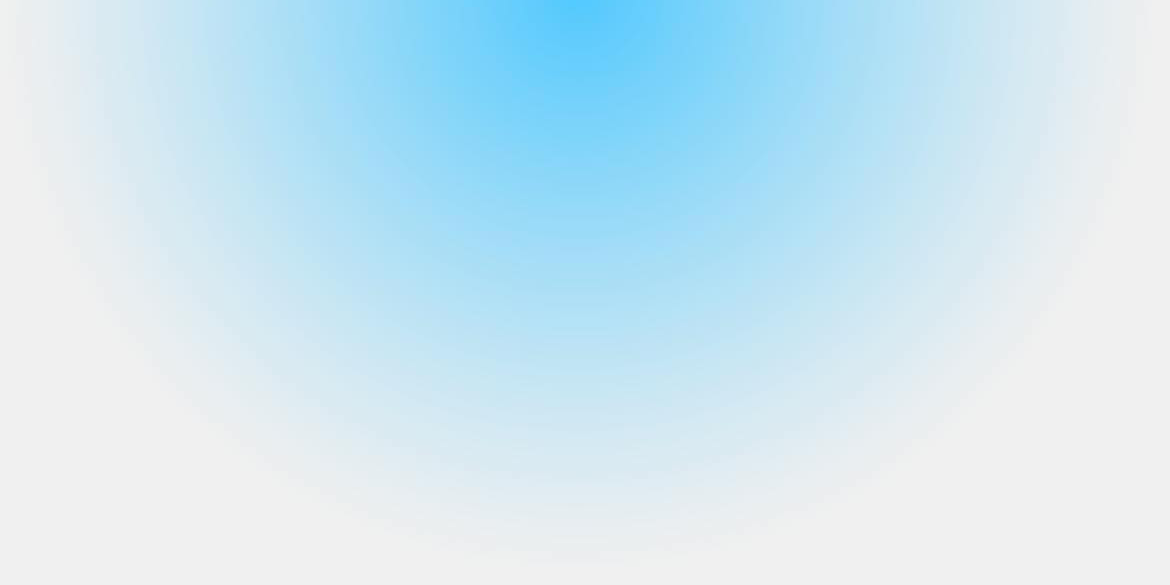Lorsqu’on parle de musique néoclassique, on se tourne assez facilement vers le centre-est, Joep Beving, Nils Frahm et d’autres encore. Pourtant réside à Paris sans doute l’un des musiciens les plus prometteurs. Son nouvel album Durango qui fait suite à l’album 88, sorti en 2018, démontre un peu plus sa qualité de musicien et d’orateur silencieux : cette expression pour désigner la capacité à énoncer un discours sans les mots, avec une pure efficacité.
Au studio Durango à Paris, Guillaume Poncelet s’est enfermé quelques mois l’année dernière pour la réalisation de son nouvel album, éponyme. Si de premier abord, les titres de l’album ne sont pas évocateurs, cela vient peut-être de sa volonté de rester parfois secret. Pourtant, d’une façon presque imperceptible, c’est en réalité sa vie qu’il raconte, tant sa pudeur dirige ses choix. On relève dans ce projet la capacité à faire parler les notes, comme dans le morceau Patricia, dédié à sa mère. Le fait remarquable naît de son attitude discrète, qui vient doucement mais sûrement soulever et réveiller des états en nous, touchant la chair et les os.
Comme on pourrait le faire dans la danse, le pianiste reprend la musique à partir de ses fondements, s’appuie sur des bases solides, pour décliner à l’infini des gestes simples et former un tout complexe. La toile de fond de Yaki Imo est un exemple de cette démarche, dans laquelle il forme un chemin répétitif qui mène à l’apothéose et donne une ampleur magistrale à l’ensemble final. D’une autre façon, dans Le Pouvoir de l’oubli, il use de la répétition comme un bruit sourd, synonyme des réminiscences d’un passé que l’on apprivoise ou décide de déposer dans un coin de sa tête, pour regarder ce qui nous paraît essentiel.
Si l’on peut dire, l’avantage d’un album comme celui-ci est qu’il n’y a pas grand-chose à faire d’autre que de se laisser porter, sans devoir pour autant entrer dans un état contemplatif exacerbé, ni s’ennuyer. Il s’écoute comme se regarde un film et comme se raconte une histoire. Écrire un scénario implique notamment une recherche de simplicité, que l’on perçoit dans la minutie qui se joue entre harmonies et bascules inattendues, au milieu desquelles des sentiments muets viennent se loger. C’est aussi une question de fluidité et de tempo, ralenti dans le titre L’autre soi. Là, on observe le slow-motion d’une alternative de vie possible, avec une certaine nostalgie. En réalité le champ des possibles est large et l’interprétation libre. C’est une des forces de cet album : il évite de se reposer sur la majestuosité de l’instrument, sur l’espace qu’il crée ou encore sur sa poésie inhérente, mais tend plutôt à sculpter sa résonance, à lui donner un sens, quitte à la ressentir.
Par ailleurs, la sourdine qu’on entend dans Eigengrau, omniprésente dans son précédent album, a laissé progressivement place à d’autres textures, notamment apportées par Louxor et ses machines. D’une façon subtile, ce dernier habille les notes autrement, les allonge et les travaille en distorsions pour mieux servir une image globale. On imagine alors avec le titre Brain Freeze un paysage bleuté que des notes plus graves viennent réchauffer. En outre, ce duo sur scène et en studio, accompagné d’autres musiciens au fur et à mesure du parcours solo de Guillaume Poncelet, a contribué au développement de ces résonances et à la construction de son univers.
Enfin il y a cette touche indescriptible, qui lui est intimement propre et qui permet de le reconnaître autant dans ses compositions pour ses acolytes Ben Mazué et Gaël Faye que dans son projet solo. Sans doute puise-t-il dans une part profonde de lui-même, et tire d’une sensibilité accrue longtemps passée sous silence un travail délicat, qu’il aime modestement rapprocher de son amour pour Chopin et Ravel. Cela n’empêche qu’il reste une voie à tracer, pour laquelle cet album ouvre la marche avec splendeur.

À la recherche des sons qui enclenchent le mécanisme de bascule de la tête et du coeur